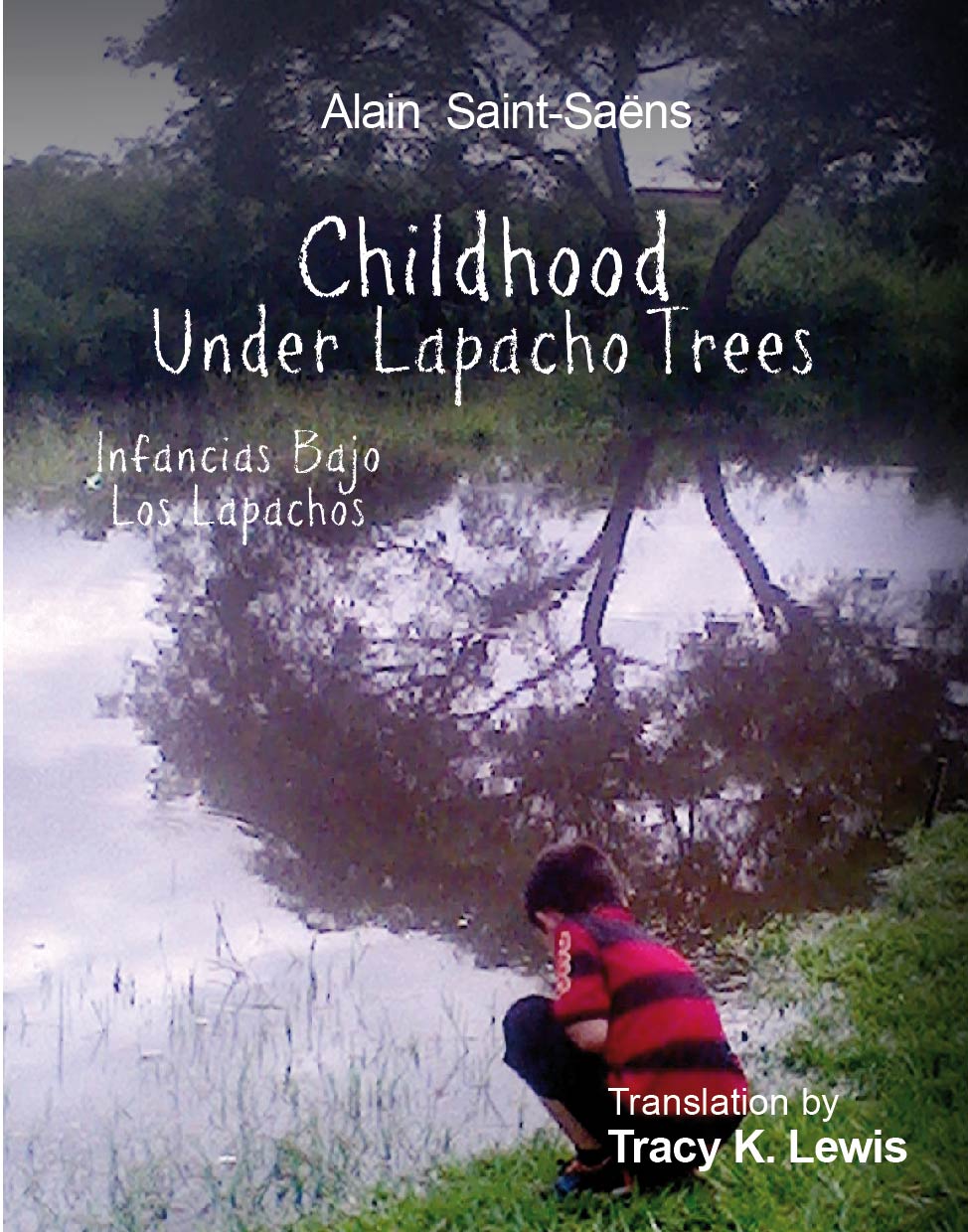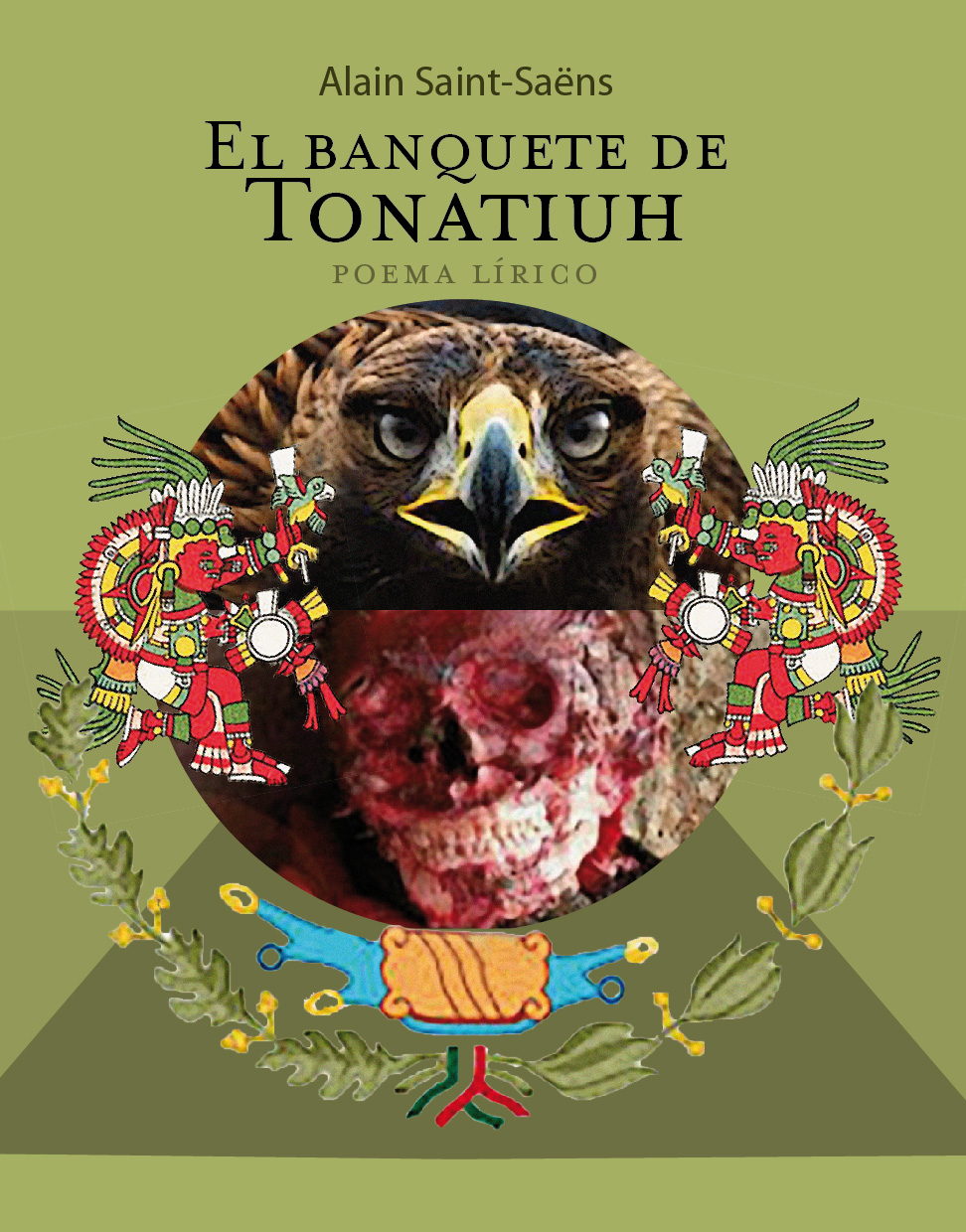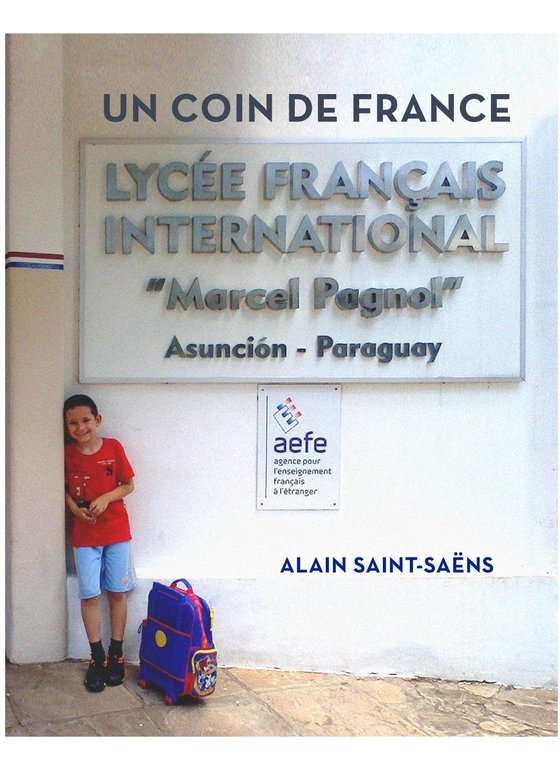Alors
que j’écris ces lignes, un virus tenace est en
train de décimer des centaines de milliers de
gens partout dans le monde. En ces moments de
terreur et d’incompréhension, la coordination
internationale est plus que jamais impérative.
Les attaques du virus ont montré que les efforts
d’éradication limitrophes ne peuvent être que
vains. C’est pourquoi il faudra penser à des
coalitions pour la survie de l’ensemble des
habitants de la planète. La pandémie, ses reculs
et ses regains, disent combien les êtres humains
sont interconnectés, au-delà des frontières
imaginaires dont l’humanité s’entoure. Tout dans
notre vie actuelle dépend du mouvement
d’ensemble et des seuils de tolérance que la
masse développe.
J’ai
évoqué la pandémie et je me rends compte qu’Aisha,
princesse de Sfax est un roman d’actualité.
Créé dans l’espoir de rassembler les hommes
autour du principe d’un destin commun,
l’objectif est sans doute de regagner ensemble
cette terre où l’humanité est précieuse. Pour ce
faire, la voix est prêtée aux défenseurs de la
cohabitation, dans la différence. Combien, en
ces temps de crise sanitaire, avons-nous besoin
de ce sentiment de solidarité qui nous unit,
toutes races et toutes origines confondues! Dans
le roman, la différence est couplée avec le sens
de civilisation. Les événements sont organisés
de manière à ce que le confort de la
civilisation occidentale, représentée par le
personnage de Roger Vasseur et l’ensemble de
ceux qui arrivent de France, soit grignoté, en
faveur de ce que j’appellerai une entente
culturelle. Tous ces étrangers installés en
Tunisie, à cause de leur travail dans des
institutions homologuées ou de par leurs
missions émanant du ministère français, se
retrouvent rassemblés autour de la question de
l’échange culturel. La volonté d’une
coopération, où les partenaires seraient traités
sur un pied d’égalité, dans une ambiance de
respect mutuel, est sensible dans les projets de
développement institutionnel et culturel
soutenus par la France en Tunisie. Par moments,
des obstacles s’opposent à cette volonté qui
peine à opérer la rupture avec l’ancienne
intervention, de style colonial. Et là, je fais
appel à une pensée de mon compatriote, feu Mahdi
Elmandjra, pour qui la communication culturelle,
dans le respect des valeurs de l’autre, est une
mesure qui empêche l’irruption de conflits
civilisationnels. La carrière de l’historien des
civilisations qu’est l’auteur même du roman
n’est pas étrangère à ce revirement qui traite,
en filigrane, de la thématique du pouvoir, de la
domination et de l’altérité. Ayant à l’esprit
les débâcles qu’ont dues subir les plus grands
empires habitués aux rapports de force, Alain
Saint-Saëns est convaincu de l’inanité des
prétentions de suprématie lorsque l’enjeu est le
développement de l’être humain.
Les
reprises d’une auto-biofiction certaine sont à
considérer comme des survivances d’une émotion
sincère envers une Tunisie que l’auteur veut
cordiale, philanthrope et spirituelle. Les
scènes nostalgiques, mises sur le compte des
déplacements de carrière, trouvent leur bonheur
dans des revanches comme celle où Roger Vasseur
pourfend Jacques-André Colin, son adjoint dans
la fonction d’Attaché Culturel, pour ses
machinations malencontreuses contre André-Marie
Stasanines, un proviseur de lycée français
réputé pour ses qualités humaines. La persona
non grata est aussitôt évincée pour
contrecarrer la menace qui règne sur les plans
de partenariat.
Le
roman est composé de microcosmes qui se
maintiennent en survie dans l’univers implacable
des grandes diplomaties. Les hommes y sont
égaux. Les femmes aussi. Sur fond de
méritocratie, Aisha fait irruption pour prêter
un trait encore plus personnalisé au bonheur des
échanges et du dialogue interculturel.
Personnage éponyme, la jeune et brillante
docteure est le produit de l’école tunisienne.
Elle a réussi dans le temps des études de
Médecine, et retenons-le bien, dans une faculté
de Sfax, ville portuaire de l’est de la Tunisie.
Ce n’est pas un hasard si les détails du cursus
universitaire, qui fait la distinction de la
jeune femme, sont repris. C’est pour souligner
toute la valeur des systèmes éducatifs et
universitaires locaux d’une Tunisie post
révolutionnaire. La jeune femme décroche le
poste de Médecin de l’Ambassade de France. La
cousine éloignée de la reine de Saba, la grande
Belkisse, réussit le défi de concilier les
paradoxes. L’imagination a voulu qu’elle fût,
elle aussi, basanée, une carnation où les
couleurs brûlées de l’Afrique viennent se diluer
dans l’ombre pâle du vieux continent.
Un
regard microscopique est à même de nous faire
apprécier la complexité anthropomorphique du
personnage. Les versets coraniques sont dans sa
bouche des litanies de l’orgie sexuelle à
laquelle elle se livre avec acharnement, en
complicité avec l’élu de son cœur, le Roger
marié, père de deux enfants et qui est son aîné
de plusieurs années. La virginité et sa
conservation reviennent dans les ébats amoureux
comme un gage d’authenticité pour celle éduquée
dans le conservatisme modéré d’une famille
sfaxienne. Je salue la concision du style
lorsque l’immensité du signifié est condensée en
deux moments narratifs.
Le
premier est celui où Aisha nous laisse pénétrer
dans son intimité féminine, par phrases
juxtaposées qui ne perdent jamais la cadence des
émois. Elle nous introduit dans les fulgurances
d’une sexualité interdite. Le lecteur sera
sûrement captif de cette complicité bienvenue
avec le personnage. Le deuxième moment est celui
où la passion pour un homme, que ni l’âge, ni la
situation familiale, ni le culte ne
prédestinaient à une union conjugale, tient tête
à la confidence. Aisha se rend à un mutisme
étranger, à ce que l’on connait du profil de la
Maghrébine qui récupère ses équilibres
psychologiques dans la confidence. Le silence
scelle la langue en présence de la mère et de
l’amie intime, non pas pour apaiser la honte,
mais pour mieux se rendre aux flux du langage
dans l’étreinte de l’étranger. Les deux parties
de ces trocs émotionnels sont bien la famille de
la jeune femme, avec le paradigme qu’elle
entraîne, celui de la constance pour le maintien
d’un système pointilleux en ce qui concerne les
usages maritaux, et Roger, l’homme de ses rêves
qui ouvre des perspectives sur l’inconnu de
l’altérité.
Les
alternatives d’une altérification mal vue par
l’entourage social et familier situent le
personnage à l’entrecroisement de plusieurs
existences, toutes possibles, sans être étalées
dans leur intégralité. Les possibilités retenues
sont celles qui s’accrochent à un fond
circonstanciel et historique qui leur procure un
sens. Aisha a du mal à se maintenir dans l’unité
du temps et de l’histoire. Pour exister, elle
est rendue à une exposition événementielle de
nature existentielle.
L’attention prêtée à l’onomastique révèle un
aspect fondamental de cette exposition. La
princesse sfaxienne, celle dont le prénom en
arabe est ouvert sur le passé et sur l’avenir du
fait qu’il signifie la femme qui a longtemps
vécu ou celle qui survit aux drames, est une
incarnation immortelle. Destinée dès sa
naissance à une mort prématurée annoncée dans le
rêve paternel, elle est non seulement la damnée
de la prémonition, mais surtout la survivante
d’un épisode essentiel de l’hagiographie
musulmane. Je laisse le lecteur découvrir la
substance de cette survivance dans les méandres
de la biographie du prophète de l’Islam, telle
qu’elle est relatée dans le roman. La
rétrospective consolide les liens entre le
présent immédiat de la narration, le présent
restreint, et un passé de teneur historique,
celui contenu dans les annales de la religion
monothéiste. À la suite de cette résurgence, la
trame est faite et défaite pour être refaite
indéfiniment entre l’Aisha actuelle et l’Aisha
historique, et occuper un temps d’attente
répétitif, incontrôlable, comme celui de la
Pénélope du mythe grec.
La
structure du roman épouse les débordements.
Aisha, princesse de Sfax ne peut se
contenter d’un jet narratif recroquevillé sur
lui-même. La continuité vient de l’organisation
en aval, où les chapitres ouvrent tous sur une
date du calendrier grégorien. Le journal
commence le samedi 2 novembre 2019 pour finir le
mardi 17 décembre 2019, jour anniversaire du
début de la Révolution tunisienne de 2012. La
chronologie hachée crée des intervalles, où les
personnages vivent ailleurs, dans des pauses
narratives habilement occultées au lecteur, mais
que l’imagination personnelle de chacun peut
meubler à volonté. Un jeu participatif pour dire
combien l’intégrité du personnage, dans le sens
de complétude, comme d’ailleurs celle de l’être
humain, est un ensemble combinatoire
d’expériences et de vécus. Grâce à l’ossature du
calendrier, à la sémiologie de la superstition,
la fatalité de la fin est arrachée au cycle de
la finitude. Tout ce que l’on pourrait retenir
du passage d’Aisha dans nos mémoires peut
s’étendre à des espaces multiples, où sont
rapprochés des êtres appartenant à des
temporalités et à des étendues existentielles
diverses.
À
l’issu de ces lignes, j’encourage vivement le
lecteur à faire d’Aisha, princesse de Sfax
une lecture personnalisée. Parce que, dans
les plis de l’histoire est tapi chacun de nous.
Que nous soyons Maghrébins ou Européens, hommes
ou femmes, dans le roman nous sommes tous
ceux-là et davantage encore, des citoyens du
monde.

Samira Etouil
Professeure Chercheuse,
Moulay Ismail University
Meknès (Maroc)